LES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA PSYCHIATRIE ANTHROPOLOGIQUE
|
|
Séance de propitiation à Pobè (Bénin)
| Plan du
Chapitre: 1) La maladie: construction d'une représentation 2) La nosographie: classification culturelle des représentations de la maladie 3) La nosologie: principe organisateur systémique des représentations de maladie 4) L'origine des maladies 5) L'axiologie symbolique: utilisation d'une nosographie traditionnelle 6) Le symbole et le diabole 7) La notion d'embrayeur symbolique et diabolique
|
"L'homme est un animal malade", disait Miguel de UNAMUNO...
Qu'est-ce qu'une maladie (mentale notamment), et comment allons-nous nous accorder à en parler? Comment l'approche anthropologique décrit-elle la fabrication d'une maladie (mentale notamment) et, beaucoup plus largement, celle d'une personnalité?
Quelles sont les bases de cette description, quelle en est la méthode, quels en sont les résultats?
1) La maladie: construction d'une représentation.
La médecine considère la maladie comme un objet naturel, et la définit comme une perturbation fonctionnelle de l'organisme. On peut accepter cette définition tout en observant qu'elle est aussi autre chose, à savoir l'idée qu'on s'en fait à titre individuel (en tant que malade, en tant que soignant, en tant que familier d'un malade...) ou à titre collectif (en tant que citoyen, en tant que membre d'un groupe culturel...). La représentation de la maladie fait partie de la maladie.
Cela est-il certain? Il est en tout cas certain que la représentation de la maladie influence le comportement du malade et de son entourage, et que cela entraîne des conséquences - parfois graves, parfois favorables - sur l'issue de la maladie.
Mais il y a plus:
- la représentation de la maladie entraîne le classement de celle-ci dans une catégorie nosographique. Le traitement des problèmes par catégorie est une constante de l'esprit, et provoque une similarité des comportements envers les problèmes ainsi groupés.
- la représentation de la maladie influence notablement le vécu du malade, facilitant pour lui le fait d'être malade ou, au contraire, rendant la chose insupportable . Elle pourrait aussi, mais c'est une hypothèse, mobiliser les mécanismes de défense de l'organisme.
- la représentation de la maladie entre pour une bonne part dans l'élaboration des stratégies et des attitudes thérapeutiques. Elle permet ou empêche des comportements thérapeutiques parfois déterminants.
Ceci est valable pour toutes les maladies, quelle qu'en soit l'origine et l'organe cible. On peut donner des exemples: la difficulté de traiter rationnellement un diabète chez des patients participant de certaines traditions, mais aussi celle de traiter rationnellement le tabagisme, l'alcoolisme ou l'obésité dans les sociétés occidentales, sont dues à la représentation sociale de ces maladies dans les sociétés considérées.
Dans le cas des maladies mentales (catégorie nosographique de tradition européenne), on est tenté de penser que la représentation est la maladie. Pourquoi? Parce que la forme que prend l'expression pathologique de ces maladies varie considérablement en fonction de l'évolution des représentations qui les concernent. L'hystérie est l'exemple type (très fréquente sous sa forme canonique, chez les femmes surtout, à la fin du XIXème siècle, elle prend aujourd'hui des formes bien cachées, on la dit même "presque disparue", mais notre société tout entière est devenue hystérique...). D'une façon générale les névroses oedipiennes font place à des états névrotiques moins différenciés, dits limites ou borderline. Les psychoses seraient plus stables? Voire... La schizophrénie se présente sous des formes tellement multiples, souvent inédites (en co-morbidité avec les toxicomanies, par exemple), et le pronostic en est tellement différent aujourd'hui de ce qu'enseignait KRAEPELIN, qu'on ne peut en parler aujourd'hui qu'à partir d'une définition large, au point qu'elle en perd toute spécificité. Les études épidémiologiques - notamment celle de l'OMS, qui concluait à une prévalence uniforme dans toutes les régions du globe - ont ainsi souvent adopté une définition (celle de l'école psychiatrique américaine) qui ne tient pas compte de différences évolutives pourtant cruciales pour le patient: une psychose spontanément résolutive et une psychose chronique sont ainsi regroupées sous le même label. Pourquoi une grande majorité des psychoses schizophréniques sont-elles spontanément curables dans la plupart des sociétés traditionnelles, et au contraire ont-elles une évolution chronique en Europe et en Amérique du Nord? Le sujet ne sera abordé que dans la mesure où l'enquête épidémiologique a posé la question.
Une fois construite (socialement) la représentation de la maladie, elle doit encore s'ancrer dans le psychisme individuel, pour qu'une personne en arrive à se définir en fonction d'elle, à se comporter en fonction d'elle, à ratifier sans cesse le jugement d'autrui qui la définit comme malade selon cette représentation.
Il n'y a du reste aucune raison de rejeter a priori l'hypothèse selon laquelle la représentation mentale d'un état pathologique par la personne qui en souffre influencerait in fine son fonctionnement cérébral.
2) La nosographie: classification culturelle des représentations de maladies.
Ceux qui ont eu la chance de pratiquer la médecine "outre-mer" savent que tous les peuples se sont forgé une classification des maladies, ou plus exactement des représentations de maladies qu'ils reconnaissent. Parfois cette classification paraîtra simpliste ou partielle à un observateur superficiel. Pourtant, elle est une fonction essentielle de la culture. Elle est d'ailleurs très loin d'être arbitraire, et mieux on la connaît, mieux on en saisit la complexité. Elle se fonde sur des catégories dont la pertinence est reconnue bien au-delà du domaine de la santé: par exemple sur une opposition polaire (le chaud et le froid, le sec et l'humide, le yang et le yin...) ou sur un système de quelques traits qui se combinent entre eux, comme dans la théorie galénique des humeurs qui a gouverné la médecine occidentale pendant mille ans. Ces traits pertinents se retrouvent dans des domaines connexes, ou en apparence éloignés: les coutumes alimentaires, matrimoniales, les mythes... Les pratiques de guérison reposent sur des liens logiques qui se forment entre les aspects homologues repérés dans ces différents domaines. Un exemple très simple: quand on souffre d'une maladie froide, on ne doit pas boire trop d'eau, qui est elle-même humide, donc froide, etc...
De telles nosographies endogènes (c'est-à-dire propres à une culture traditionnelle non occidentale) concernent aussi la psychiatrie, à ceci près que la distinction entre maladies physiques et maladies mentales est rarement tranchée, ou en tout cas pas de la même façon qu'en Occident. L'homogénéité des catégories nosographiques y est souvent constituée par l'étiologie, autrement dit la cause reconnue aux maladies. Une même catégorie nosographique (par exemple l'ensemble des maladies causées par l'attaque d'un sorcier) peut regrouper de façon logique des maladies mentales (comme une crise d'angoisse avec peur de mort imminente) et d'autres auxquelles le médecin occidental attribue une cause physique (comme une crise de paludisme grave). On peut très bien admettre que le Plasmodium falciparum soit responsable de la crise de paludisme, sans méconnaître pour autant le rôle déterminant du sorcier. Car pourquoi le moustique a-t-il précisément piqué cette personne-là à ce moment-là? La cause opérante peut toujours être différente de la cause efficiente.
La grande question reste de savoir si ces nosographies traditionnelles, qu'elles soient populaires ou savantes, ne sont que des théories appelées à être remplacées par d'autres plus exactes (celles de la science positive) ou si elles possèdent une pertinence particulière lorsqu'on les applique au domaine culturel qui est le leur. La psychiatrie anthropologique leur reconnaît cette pertinence particulière. Pour comprendre cette position quelque peu provocante, il est nécessaire de saisir l'existence d'un principe organisateur sous-jacent, tant à la nosographie culturelle qu'à la fabrication d'un état pathologique individuel.
3) La nosologie: principe organisateur systémique des représentations de maladies.
Un système est composé d'éléments en interaction. Le terme d'interaction implique que toute modification apportée à l'un des éléments affectera chacun des autres. Quand on compare les unes aux autres les nosographies fonctionnant dans différentes cultures, on a d'emblée l'intuition que ces notions s'appliquent à elles de façon pertinente:
- On voit, en effet, des catégories causales prendre plus ou moins d'ampleur, se transformer, se dédoubler, disparaître parfois en étant remplacées par d'autres qui semblent occuper différemment une place homologue dans le système. Par exemple, en Afrique Centrale et dans le Golfe de Guinée, la sorcellerie se confond pratiquement avec les pratiques d'envoûtement (tout le monde peut être sorcier). Elle s'en distingue par contre nettement au Sénégal (les sorciers sont des êtres à part). Au Maghreb, elle est remplacée par plusieurs formes différentes d'influence maléfique immédiate (c'est-à-dire ne faisant pas appel à des objets intermédiaires) comme le mauvais oeil, la mauvaise nourriture..., qui tendent à se rapprocher des pratiques médiates (poupées piquées d'épingles, objets enterrés...) sans se confondre avec elles. En Europe du Sud existent les mêmes croyances qu'au Maghreb, mais la notion d'empoisonnement tend à se substituer à celle de mauvaise nourriture: c'est une modernisation de la notion africaine de viande de nuit. Plus au Nord enfin, l'ensorcellement semble essentiellement reposer sur des pratiques médiates, sans faire disparaître cependant la notion de mauvais oeil.
- En ce qui concerne les catégories syndromiques (les formes que revêtent les maladies), on constate des transformations homologues: il existe, pour chaque catégorie causale, des syndromes typiques pour lesquels l'attribution ne fait aucun doute, et des syndromes atypiques dont la cause est douteuse. La fréquence d'un syndrome typique varie, d'une culture à l'autre, en fonction de l'importance que revêt ce qui le cause pour la nosographie culturelle en question. Il semble donc que le malade construise les symptômes de sa maladie avec les matériaux culturels qu'il a à sa disposition.
Pour autant, la nosographie culturelle ne doit pas être considérée comme un principe organisateur satisfaisant: elle n'est qu'une tentative culturelle de s'approcher le mieux possible du véritable principe organisateur des maladies, lequel demeure inaccessible. On constate, en effet, l'abondance des syndromes atypiques, et on se dit que la nosographie culturelle n'est qu'un instrument bien imparfait. A cet égard, on le sait, la nosographie occidentale ne fait pas exception. On constate surtout que le patient, surtout s'il est psychotique, consacre une part de son énergie d'élaboration à transformer les données culturelles, et on se demande ce qui le pousse, et dans quelle direction. On retrouve, à ce moment, la notion freudienne de causalité psychique: il existe des processus psychodynamiques, échappant aux déterminismes sociaux tout en s'appuyant sur eux, qui déforment (élaborent) les données collectives en fonction d'impératifs individuels. Mais il y a autre chose:
La culture ne se réduit pas à ce qu'on peut en dire. Il y a dans le fonctionnement culturel, une bonne part d'implicite et de caché. Ce qui apparaît en pleine lumière, ce n'est jamais que le discours (auto-justificateur, idéologique) que la culture tient sur elle-même. La nosographie fait partie de ce discours, qui par nature ne peut rendre compte que de l'aspect le plus conformiste de la pathogenèse. Il faut donc postuler, et essayer d'atteindre, derrière la nosographie culturelle, un véritable principe organisateur que nous posons comme inaccessible dans son entièreté, et auquel nous donnons par convention le nom de nosologie.
La nosologie, dans notre acception, est donc un système culturel implicite, déterminant la construction des maladies mentales et la forme syndromique qu'elles prennent, sans que les individus en soient conscients, et sans que la sagesse des maîtres du savoir ou la science des savants n'en possèdent autre chose que des bribes. La nosographie devient, dans cette perspective, ce qui vient dans le discours de la culture occuper la place de la nosologie c'est-à-dire, ce que la culture a réussi à en savoir.
4) L'origine des maladies.
Sans préjudice d'autres origines, notamment biologiques, la psychiatrie anthropologique met l'accent sur une double causalité: d'une part l'appartenance culturelle des gens, d'autre part leur position sociale.
- L'appartenance culturelle met les êtres humains au sein d'un réseau de significations, et leur y assigne une place qui leur est propre, et qui les définit aux yeux des autres et à leurs propres yeux. Il s'agit là d'une nécessité vitale. Les effets sont positifs, sauf lorsque la place attribuée est floue, mal définie, ou carrément défavorable. Mais il arrive que cette place ne se révèle défavorable que dans des circonstances particulières, comme par exemple en cas de changement culturel brusque, lors d'une migration notamment. Il arrive enfin que l'individu découvre, un peu par hasard, qu'en fondant son identité propre sur cette position il la construisait sur un terrain instable. Comme on vient de le voir en effet, la culture possède des failles. Elle prétend rendre compte de l'expérience humaine, mais elle est loin de pouvoir le faire d'une manière vraiment satisfaisante. Elle comporte des contradictions qui portent parfois atteinte à la cohérence de l'ensemble, et qui, même lorsqu'elles ne portent que sur un aspect marginal, peuvent être graves pour la personne particulière qui avait basé sur elles son existence. La révélation de cette contradiction joue alors le rôle d'événement déclenchant d'une maladie mentale (voir plus loin: diabole).
- Le jeu des rapports de force au sein de la société joue également un rôle pathogène. On constate que la trajectoire sociale des patients psychiatriques est presque toujours descendante. Peu importe ici qu'il s'agisse d'une cause, ou de l'effet d'une maladie préexistante: même dans ce dernier cas, la dégradation de la position sociale entraîne un cercle vicieux qui entretient ou renforce la maladie. Dans les hôpitaux, ces phénomènes sont perceptibles de façon quasi expérimentale: le malade hospitalisé se trouve - provisoirement ou non - au bas d'une échelle sociale où les médecins, le chef infirmier... occupent les hautes marches. Il essaie d'exister dans ce milieu, d'y retrouver une position, dans une relation de concurrence avec d'autres patients. Les échanges internes entre patients jouent là, à très petite échelle, le rôle régulateur que tiennent, dans la société globale, les échanges internationaux ou les transactions boursières: celui de fixer la valeur des choses et des gens. Certains s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent lors de ces échanges. Un peu en argent, énormément en capital symbolique. Le problème, c'est que le capital symbolique qui a cours dans l'hôpital n'est que de la monnaie de singe à l'extérieur. Ceux des patients qui réussissent à améliorer leur capital symbolique, restaurent cependant par là leur position sociale et ont de meilleures chances de quitter l'hôpital dans de bonnes conditions.
La culture, en tant que système symbolique, fournit aux échanges les marques de valeur, les repères fondamentaux. La marche des échanges précise elle-même la valeur des choses et des gens en fonction de l'offre et de la demande. La position sociale des personnes monte et descend, selon qu'ils gagnent ou perdent du capital symbolique. Celui qui gagne du capital symbolique gagne également du prestige social, et la possibilité d'acquérir plus facilement les ressources matérielles ou symboliques dont il a besoin. Les autres doivent s'en passer, à moins qu'ils n'utilisent des moyens d'appropriation illégitimes tels que le vol, le rackett... De nombreux troubles du comportement trouvent ici leur origine.
Ce qui est décrit ici, c'est de la façon la plus générale qui soit, le processus pathogène (quand le capital symbolique se perd et que la position sociale dégringole) et le processus thérapeutique (dans le cas contraire). Ce qui met en marche ces processus, c'est l'échange des biens et celui des signes, c'est-à-dire l'interaction des êtres humains. L'interaction est continuelle et indéfinie. Elle produit continuellement des résultats: des séquences comportementales, et des représentations (car nous sommes faits de telle façon que nous nous représentons toujours ce que nous faisons et ce que nous sommes en le faisant). Une des représentations les plus importantes, en ce qui nous concerne, est évidemment l'identité personnelle (imaginaire et symbolique) qui est toujours perturbée dans les maladies mentales et dissociée dans la schizophrénie.
5) L'axiologie symbolique: utilisation d'une nosographie traditionnelle:
Une nosographie traditionnelle, celle qui a cours au Sénégal et dans les pays voisins, étudiée par l'Ecole de Fann (notamment par H. COLLOMB, M. DIOP, E. et M-C. ORTIGUES, A. ZEMPLENI, J. RABAIN), nous a permis de comprendre trois choses:
qu'elle procède d'une pensée rigoureuse, qui décrit phénoménologiquement et structuralement les maladies mentales (et quelques autres) comme la conséquence de troubles de la relation entre l'être humain et le monde du sacré.
que cette pensée acquiert une portée universelle, dès lors qu'on admet l'existence d'une relation métaphorique entre les instances du sacré et les fondements de la vie sociale: la Filiation et l'Alliance.
que le lien causal entre les troubles de la vie sociale (ou au choix, de la relation au monde du sacré) et la maladie mentale, passe par la notion d'identité personnelle et par la manière dont cette identité se construit et se défait.
Voyons cela:
Il existe quatre grandes causes de maladie mentale, selon les guérisseurs sénégalais: en langue wolof, les Jiné, les Rab, les Dömm, le Ligeey. Entre elles, les combinaisons sont multiples, permettant une interprétation subtile des variétés cliniques rencontrées.
Les Jiné: il s'agit d'êtres spirituels, analogues ou identiques aux Djnoun arabes (sing. Djinn). Le mot est visiblement d'origine arabe, peut-être a-t-il remplacé un mot antérieur à l'Islamisation. Ces esprits peuvent agresser un être humain qui les aurait dérangés, ou bien le rechercher sexuellement. On décrit différentes modalités d'agression dont la soudaineté est le caractère commun, et la chronicité le lot habituel.
Les Rab: notion particulière aux Wolof et Lebou (mais on trouve des équivalents dans toutes les ethnies imparfaitement islamisées de la région), le Rab est un esprit analogue au Jiné mais qui s'est lié à une lignée humaine (dans certains cas, à un village ou une ville) par une relation d'alliance qui suppose l'existence d'un culte domestique ou local. Ces esprits alliés peuvent être mécontents, en cas d'inobservance du culte qui leur est dû, ou de toute autre forme d'infidélité. Le rétablissement du culte et des obligations négligées mène à la guérison. Là aussi, l'alliance peut revêtir la forme anarchique d'un lien de nature sexuelle.
Les Dömm ou Sorciers Anthropophages: ce sont des êtres humains cherchant à satisfaire leurs désirs en dépit de toute loi. On se les représente comme des êtres nocturnes, capables de voler, dérobant aux autres hommes leur force vitale (d'où la notion métaphorique d'anthropophagie), et formant des confréries dont les membres sont liés par l'obligation de se rendre les uns aux autres la chair humaine dérobée. La qualité de Dömm est héréditaire, par la lignée utérine exclusivement. On peut aussi devenir Dömm par contamination: en ayant mangé de la chair humaine, même sans le savoir. L'attaque des Dömm est brusque et intense, conduisant normalement à la mort. Des pratiques de protection et de guérison existent.
Le Ligeey ou "travail" est le mot qui désigne les pratiques d'envoûtement. Tout être humain peut y recourir, en le pratiquant lui-même ou en recourant aux services d'un spécialiste, par envie ou pour se défendre, ou encore pour rétablir l'égalité entre personnes d'un même rang social (car il est considéré comme injuste de "dépasser ses frères"). La personne envoûtée se sent malade ou limitée dans ses possibilités (sexuelles, génésiques, intellectuelles...) sans que la vie soit généralement en danger.
Chacune de ces explications causales se trouve être en relation avec les axes de l'identification personnelle, telle qu'elle s'opère dans la société wolof-lebou:
Le Rab est clairement en relation avec la Filiation, paternelle et maternelle, puisqu'on peut dire que chaque lignée a ses Rab qui se transmettent de génération en génération, et que la présence des Rab dans une lignée est un effet rémanent de l'alliance conclue avec eux par les Ancêtres. L'attaque d'un Rab représente le danger qui émane d'une infidélité à ceux-ci.
Le Ligeey est clairement en relation avec l'Alliance, qu'elle soit matrimoniale ou, plus largement, sociale, puisqu'on est envoûté, en principe, par ses pairs de rang ou d'âge, et que l'envoûtement apparaît ainsi comme une conséquence malheureuse de l'Alliance et, plus particulièrement, de l'Alliance mal conclue (celle qui laisse une dette impayée).
Le Dömm est plus difficilement classable. Il représente l'humanité qui refuse de se soumettre à la Loi. Dans une société qui donne une égale importance aux lignées paternelle et maternelle, il peut figurer la destruction du lien social et de l'identité par la confusion entre les deux lignées, c'est-à-dire l'inceste. Dans une société patriarcale, il figure plutôt le danger que fait courir à la famille et à la société la Mauvaise Mère et sa lignée, c'est-à-dire la parenté qui excipe de ses droits anciens pour se rebeller contre la Loi du Père.
Le Jiné est un être étranger à la société des hommes et ne leur est ni parent, ni allié. Alors que les trois autres représentations sont trois formes de danger provenant de déformations du lien social entre les humains, le Jiné représente dès lors le danger qui émane du monde non humain.
On peut représenter cela graphiquement:
![]()
Sociétés à système de parenté mixte Sociétés patrilinéaires
Le schéma de gauche convient à une société qui a conservé dans son système de parenté les deux filiations, paternelle et maternelle, figurées par les axes diagonaux. Le schéma de droite représente les axes d'identification de la personne dans une société régie par un système de parenté patrilinéaire, où seule compte la filiation paternelle, figurée par l'axe vertical. L'axe horizontal représente dans les deux cas l'alliance sociale et matrimoniale. La ligne diagonale, au tracé interrompu, dans le schéma de droite, est ce qui reste de la filiation maternelle dans la société patriarcale. Les croyances traditionnelles qui s'y rapportent sont indiquées par leur nom wolof, à la place qui convient.
Si nous tenons compte du fait que tout être humain a deux parents, deux lignées, et doit conclure une alliance (matrimoniale) pour se reproduire, si nous admettons d'autre part que notre insertion symbolique dans ce réseau constitue l'essentiel de notre identité personnelle, nous en conclurons que ce schéma possède une portée universelle. Et cela se confirme, car ce n'est pas seulement dans le contexte wolof-lebou que les troubles mentaux peuvent être lus comme des traces laissées par des événements antérieurs (traumatismes, conflits lignagers, confusions identitaires "incestuelles") transmis d'une génération à l'autre et affectant l'identité personnelle de la personne malade.
Dans plusieurs cultures océaniennes, le rôle du père est officiellement méconnu. Les femmes sont censées être fécondées par des esprits ancestraux. Les maris sont déchargés de toute responsabilité et de tout droit sur "leur" progéniture. Même si cette croyance n'empêche nullement les hommes et les femmes de "jouer" ensemble, ce sont bien les croyances officielles (au sein de la culture de ces peuples) qui déterminent les rôles et les positions sociales. Dans ces sociétés, c'est l'axe paternel qui est effacé. Par rapport à notre schéma la situation est la suivante:
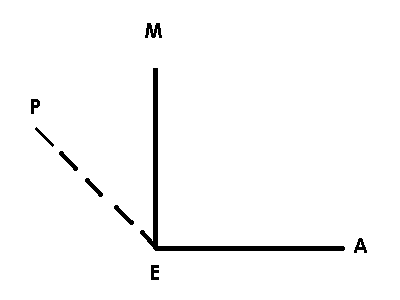 |
![]()
![]()
![]()
Société matrilinéaire
Dans notre société de tradition occidentale, telle qu'elle existait, par exemple, au début du XXème siècle, le modèle familial est patriarcal. Des circonstances particulières ont toutefois conduit à un autre type d'effacement: les ancêtres ont cessé d'être plus importants que les géniteurs immédiats; peu à peu, la relation particulière entre un homme et une femme est devenue plus importante que le lien créé à travers eux entre deux familles. La famille a cessé d'être lignagère pour devenir nucléaire. Voici ce que devient le schéma dans ce cas:
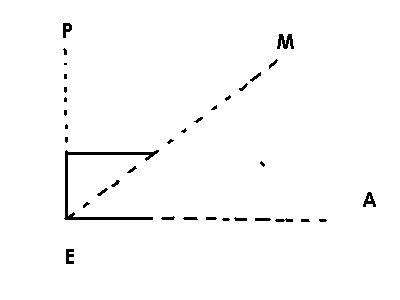 |
Société à familles nucléaires
C'est à cette époque que FREUD a fait du mythe d'Oedipe un complexe universel, et un modèle d'organisation psychique. Dans notre modèle, nous situons le triangle oedipien (père, mère, Ego) à l'intérieur du schéma plus large des lignées et de l'alliance: de fait, la structure oedipienne est universelle, mais prend son relief particulier dans la mesure où une structure plus large, assurant l'identification personnelle par l'insertion de l'individu dans un réseau de relations lignagères, se révèle défaillant. Dans une famille nucléaire, la rivalité oedipienne devient la meilleure façon sinon la seule, pour un individu, de réussir son identification personnelle. On peut montrer que le mécanisme de cette identification personnelle s'est lui-même modifié: dans une société lignagère il se fonde sur l'insertion dans un réseau relationnel organisé par les lignées et les rapports sociaux; dans la société moderne il repose sur l'affirmation solitaire de soi à travers la rivalité et la compétition.
L'évolution de la famille occidentale se poursuit. De nos jours, la famille nucléaire n'est plus véritablement la norme, le rôle symbolique du Père s'est affaibli, les repères oedipiens se brouillent. Pour les jeunes, la principale référence semble être de plus en plus souvent leur appartenance à un groupe de jeunes de même âge. La situation peut dès lors se décrire ainsi:
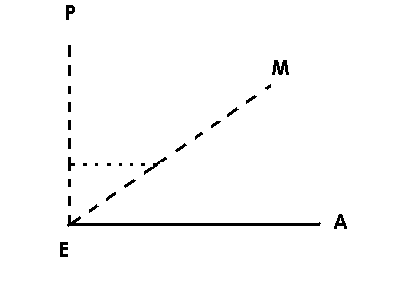 |
Société "post-moderne"
Les deux axes de la Filiation sont à présent défaillants dans leur fonction symbolique: l'axe maternel, parce qu'il a perdu depuis des siècles sa légitimation sociale; l'axe paternel parce qu'il souffre d'une carence récente. En revanche, l'axe d'alliance prend une importance compensatoire. Si la "bande" vient à disparaître, le jeune peut être totalement désemparé, avec des conséquences cliniques (TS...). D'autre part, pour être moins efficaces, les autres axes n'en restent pas moins actifs, d'une autre manière: un principe de clinique anthropologique africaine, qui semble valable en Europe, est qu'un axe qui ne sert pas à l'identification symbolique se met à produire des symptômes. En d'autres termes nous sommes malades de ce que nous sommes (identité personnelle), et nous sommes ce que nous permettent d'être les symboles qui nous définissent.
6) Le symbole et le diabole.
Il faut redire le lien qui existe entre les symboles et la culture. Nous considérons la culture comme un réseau de significations qui renvoient les unes aux autres, et forment ensemble une sorte de carte symbolique du monde. Les éléments signifiants qui forment ce réseau, nous les nommons symboles. La caractéristique des symboles est leur double relation de signification: d'une part avec l'objet qu'ils symbolisent (le signifié), d'autre part avec les autres symboles. Il faut en effet, que les éléments composant la culture forment ensemble un tout cohérent, doté de la faculté d'expliquer le monde d'une façon convaincante pour la plupart des gens. C'est ce que veut dire d'ailleurs, en grec le mot symbole (σύμβολον) qui vient du verbe συμβάλλω qui veut dire littéralement "jeter avec", c'est-à-dire notamment "rapprocher, mettre en relation, comparer, etc...". Le symbole est, primitivement, l'objet coupé en deux dont la réunion permet la reconnaissance mutuelle des porteurs: en somme, la réunion fait sens.
A l'inverse, il existe un verbe διαβάλλω, "jeter à travers", qui en vient à signifier "séparer, désunir" et aussi, entre autres, "calomnier, tromper". Le substantif dérivé est διάβολον, "ce qui désunit", et aussi "calomnie". La forme masculine de ce mot est διάβολος, le calomniateur, et aussi, dans la tradition chrétienne, le diable. L'image est celle d'un élément qui, par rapport aux autres, cesse de faire sens parce qu'il détruit l'union, la cohérence de l'ensemble. En somme, la désunion fait disparaître le sens.
Il existe donc une antinomie étymologique entre le symbole et le diable. Mais à quoi cela correspond-il dans la réalité?
Quand le délire s'empare d'un patient, celui-ci vit une expérience très pénible, très angoissante, où il voit s'effondrer ses repères. Il perd le sentiment d'évidence des choses. Ce sentiment était dû, simplement, à l'impression de cohérence que la culture, tant qu'elle fonctionnait bien pour lui, lui donnait du monde qui l'entourait. L'expérience délirante primaire est , au contraire, celle d'un monde incompréhensible, où notamment les limites entre soi et non-soi sont abolies. Cette expérience est souvent attribuée à l'envahissement de soi par une force extérieure, dont le diable est, dans nos cultures, une figure exemplaire. Si nous donnons au mot symbole son sens étymologique signalé ci-dessus, nous pouvons aussi bien désigner par le mot diabole son antonyme, à savoir l'élément qui détruit la cohérence de l'expérience vécue. Or cet élément existe, on le retrouve quasi systématiquement chaque fois qu'on le recherche dans l'anamnèse de patients psychotiques, pour autant qu'ils soient suffisamment proches encore du moment inaugural de leur psychose. Très vite, en effet, l'élaboration délirante gomme le souvenir du trouble initial, et y substitue une cohérence secondaire, délirante certes, qui rend au patient un semblant de sécurité.
Sous quelle forme le diabole se rencontre-t-il? Dans le récit que les patients font de leurs premiers moments de délire, on trouve souvent un objet, un mot, une conviction, une voix, en somme quelque chose qui change brusquement l'ordre établi, et à partir de quoi rien ne sera plus jamais pareil. Cette chose est et restera inexplicable, un pur factum brutum, autour duquel le délire ultérieur déploiera sa vaine tentative de reconstituer l'évidence perdue.
Pour tout commentateur extérieur, pourtant, ce diabole est un objet symbolique comme les autres, même pas spécialement mystérieux. Il s'agit en effet d'un symbole, mais dont le sens a fait l'objet pour le patient psychotique et lui seul, d'une dénégation radicale (Verwerfung, forclusion), au point qu'il ne peut plus être réintégré dans un contexte signifiant.
Reconnaître le diabole, c'est connaître l'endroit précis où la raison a vacillé, et le spectre qui l'habitait. C'est saisir, d'un coup, ce que le patient a vu dans le miroir que la culture lui tendait: une faille personnelle en relation avec une faille culturelle; un lieu géométrique où le collectif et l'individuel se confondent pour découvrir ensemble le vide qui les fonde.
7) La notion d'embrayeur symbolique et diabolique.
Cette notion provient de Roman JAKOBSON, le linguiste, qui appelait embrayeur (en anglais shifter) le pronom personnel. Il constatait que le pronom différait précisément du nom en ce qu'il ne désignait par lui-même aucun objet, aucun référent précis, mais qu'il était capable d'aiguiller le discours sur une voie ou sur une autre. Dans une conversation, celui qui se nomme Je devient Tu à la phrase suivante, et le changement de pronom indique que le locuteur a changé. Gymnastique permanente, à laquelle sont habitués les être parlants que nous sommes au point de la trouver facile. Mais ce n'est pas l'avis des jeunes enfants qui apprennent à parler, ni de certains psychotiques qui tiennent à accrocher leur identité fragile à un vocable unique et stable, parlant d'eux-mêmes à la troisième personne (c'est le plus sûr), ou bien (s'ils ne se voient que dans le désir d'un autre) à la deuxième personne.
Jeanne FAVRET-SAADA, anthropologue qui étudiait l'ensorcellement dans le Bocage normand, a repris cette notion d'embrayeur dans une acception particulière. Elle avait remarqué chez certains désorceleurs (ceux ou celles qui retirent le mauvais sort jeté) une pratique étonnante qui leur permettait de mobiliser la violence latente des victimes et de l'aiguiller vers l'attaque: attaquer le Sorcier pour se défendre, cesser par là d'être accablé et résigné, devenir peu à peu entreprenant et sûr de soi. Cela ne peut d'ailleurs qu'être favorable à l'entreprise agricole des victimes et combattre la malchance chronique dont ils souffrent. L'auteur parle à propos de cette pratique d'embrayeur de violence.
La famille est le groupe le plus proche, chargé de construire la personne de l'enfant qui y naît en l'insérant dans une structure sociale symbolique. Elle est aussi, forcément, le lieu où se produisent les ratés de cette construction. Henri COLLOMB a décrit (à propos du Sénégal, mais il aurait pu le faire partout où il y a des humains) des situations où les relations familiales mettent les membres de la famille en rivalité permanente, à cause de l'ambiguïté des processus d'identification. Dans de telles familles peut exister une violence flottante, un désir de mort qui, au départ, n'a pas d'objet précis, mais qui se focalise tout à coup sur quelqu'un avec des conséquences graves (H. COLLOMB, Sorcellerie-Anthropophagie, genèse et fonction, L'Evolution Psychiatrique, XLIII, III, 1978). Ce qui permet précisément de passer de la violence flottante à la désignation d'un objet de la violence (en la personne d'un membre du groupe, souvent un enfant, victime désormais de processus d'ailleurs totalement ou largement inconscients), c'est - au sens de FAVRET-SAADA, mais dans un autre contexte - un embrayeur de violence.
Généralisons ces notions:
Grâce à ses pronoms personnels, le langage a, comme l'Oedipe, une structure triangulaire (Je, Tu, Il). On peut admettre qu'elle concourt à la structuration de la personnalité de l'enfant: une personnalité n'est pas psychotique dans la mesure où elle est devenue capable de se distancier de l'objet de son désir, de ne pas l'halluciner, de ne pas confondre la chose avec le mot qui la désigne, et la "gymnastique pronominale", dont nous parlions plus haut, est là pour l'y aider en même temps qu'elle est un critère de réussite. Le bon usage des pronoms repose sur la réciprocité des échanges symboliques: il faut en effet que la sécurité des personnes (et de leur désir) soit garantie dans l'échange, pour qu'elles puissent renoncer à leur toute-puissance et à leur identification imaginaires, et se livrer au jeu risqué, mais fécond, des relations triangulaires qui impliquent la reconnaissance d'autrui en tant que personne jouissant d'un statut et d'un droit égal au sien propre.
Lorsque ces conditions de sécurité et de réciprocité ne sont pas garanties, les échanges langagiers se font sur un mode particulier que l'observation peut déceler: un grand nombre d'énoncés n'ont pas de destinataire défini, ni même de destinateur clairement précisé; les mêmes phrases, ambiguës, vaguement agressives, sont dites par l'un, par l'autre, sans qu'on sache vraiment à qui elles s'adressent; les énoncés ne permettent de définir ni les locuteurs, ni les relations existant entre eux; les termes pronominaux sont vagues et souvent impersonnels ("on"); la fonction d'index (ou de shifter) des pronoms n'est plus remplie correctement. Ces énoncés, chargés d'affect, font peser une menace diffuse qui s'ajoute à l'imprécision des rapports interpersonnels. Mon hypothèse est que dans ces conditions, il est tentant de faire appel à un autre type d'index pour remplacer les pronoms personnels défaillants. Cet autre index est l'embrayeur diabolique, qui fonctionne selon le mode de l'identification projective imaginaire.
Dans cette conception, on peut dire que l'embrayeur diabolique est un pronom imaginaire non-personnel, qui transforme le langage symbolique en langage imaginaire. Dans la mesure où il est appliqué à l'un des membres du groupe familial, il le transforme en patient désigné. Affectant son identité personnelle, il le transforme en psychotique. L'embrayeur diabolique n'est, du reste, pas un mot. C'est une fonction linguistique (une manière de parler dans un contexte déterminé) qui, au lieu de contribuer à la clarté de la communication, est une fonction de non-sens. Elle sert à la fois à désigner quelqu'un qui, dans le groupe, sera désormais le fou, et à désigner ce qui, dans le discours du fou et du groupe familial tout entier, n'aura désormais plus de sens. Il agit à deux niveaux:
désigner ce qui dans le discours n'a plus de sens symbolique et doit être traité désormais comme du réel (factum brutum).
désigner la personne qui tiendra désormais préférentiellement le discours imaginaire et se définira en fonction de lui.
 |
 |
 |
Bas-reliefs ornementaux du palais du roi Ghezo à Abomey (Bénin).
![]()